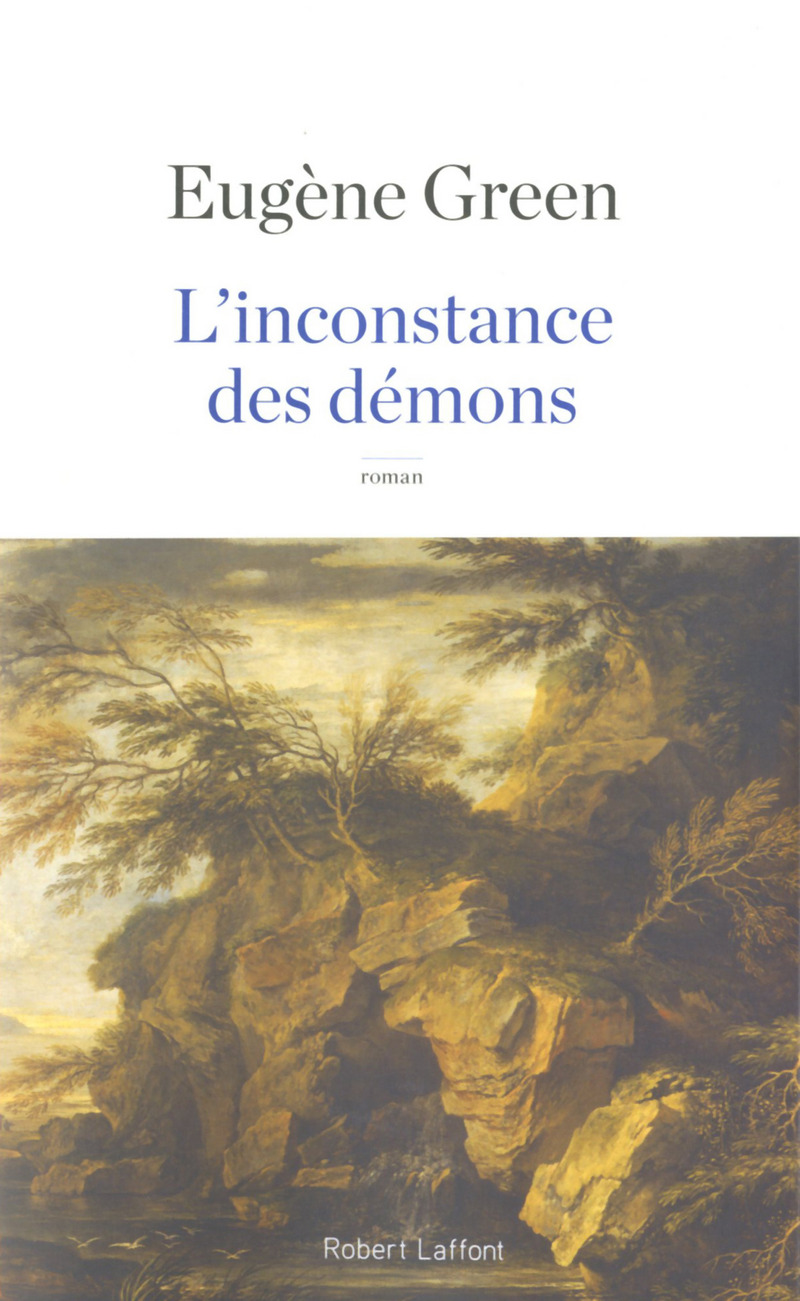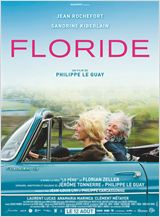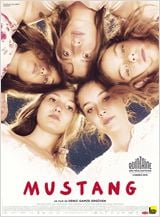J'étais heureux de lire un nouveau Eric Holder qui, il faut que je l'avoue, m'avait procuré de réels plaisirs de lecture il y a quelques années. On le retrouve donc cette rentrée remarquablement en forme si j'en juge le clip de présentation sur le site du Seuil. Oui, c'est tendance depuis quelques années (et peut être encore plus cette saison ), les auteurs, tels des chanteurs, se doivent de présenter leur nouveau livre dans un petit film. Bronzé, sautillant, vêtu d'une chemise à fleurs du plein effet, Eric Holder, s'essaie à une présentation de camelot pour "La saison des bijoux" qui, restons dans la tonalité, se déroule sur un marché. On voit bien que ce n'est pas sa spécialité. Il a beau essayer d'y mettre du coeur, mais l'emphase forcée avec laquelle il lit son texte ne m'a pas paru bien convaincante.
Peu importe cette concession au marketing d'aujourd'hui, mais jugeons donc le roman sur lecture. Nous sommes dans le Sud-Ouest de la France où une famille de marchands de bijoux lyonnais décide de passer toute la belle saison à vendre ses produits, objets peu présents dans ce marché balnéaire de Carri. Ils vont vite s'apercevoir que l'on ne se fait pas n'importe comment une place dans un endroit où de vieilles règles, plus ou moins tacites et flirtant avec l'illégalité et le despotisme, régissent placements et humains. A la tête de cette petite mafia locale, un dénommé Forgeaud, rustre et suffisant, qui en plus de jouer le chef incontesté, se met en tête de coucher avant la fin de la saison avec la vendeuse de bijoux.
Comédie humaine, hésitant entre rires et larmes, "La saison des bijoux " ne m'a guère convaincu. Ca débute plutôt pas mal. La famille Bijoux est sympathique et attachante. Mais très vite le roman commence à pâtir d'une multitude de personnages (ils sont nombreux les camelots sur ce marché !), tous avec des surnoms, qui m'a un peu perdu. C'est qui celui-là ? ...Ah oui le marchand de Fromage ... Puis le récit prend son rythme de croisière au gré de péripéties somme toute assez plates, faisant penser à un scénario pour téléfilm FR3.
Il y a bien par moment, au milieu de dialogues de bar du commerce quelques fulgurances d'écriture, parfois un peu précieuses, souvent destinées aux descriptions ( Le soleil (...) éclaboussait en revanche le champ attenant, la prairie fleurie où le vent, par instants, en redressant les touffes de molinie et la folle avoine, faisait clignoter les couleurs.). Nous avons droit également à deux emballements du récit, aux connotations sexuelles violentes, sensés sans doute être des climax mais qui donnent à ce texte un côté déséquilibré, voire peu crédible dans cet environnement très planplan. J'ai lu le tout sans grande passion ni grand intérêt. C'est toute de même le gentil portrait d'une profession peu présente dans la littérature, tout comme une plongée amusante dans une province bien moins tranquille qu'il n'y paraît. Quelque soit le lieu, l'environnement, les salauds sont partout, le pouvoir tyrannique s'exerçant même à petite échelle.
Plus léger que d'habitude mais, hélas, bien moins convaincant, ce retour d'Eric Holder laisse un goût d'inachevé, de convenu, un peu sans doute comme la plupart des articles que l'on offre à nos envies sur les marchés d'aujourd'hui.
Pour le clip, c'est ICI