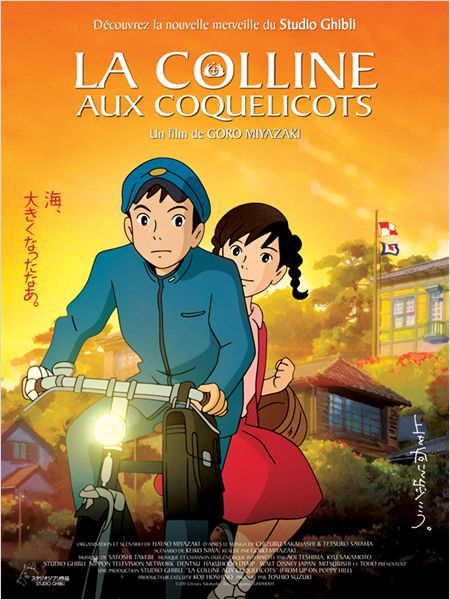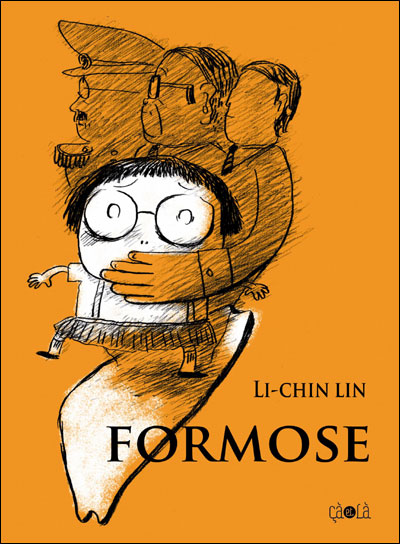Après avoir vraiment aimé un précédent livre "Les ronces" en 2006, je lis régulièrement Antoine Piazza. Avec plus ou moins de bonheur il faut dire. "La route de Tassiga" ne m'avait guère emballé et "le voyage au Japon" m'avait beaucoup plus intéressé par son côté récit de voyage.
Avec "Le chiffre des soeurs", l'auteur continue d'explorer sa vie et c'est cette fois-ci se retourne vers le passé pour nous parler de sa famille et surtout de ses tantes.
La première chose qui impressionne quand on ouvre un livre d'Antoine Piazza, c'est la densité de l'écriture. Densité, pour l'oeil, car, son texte est absent de tout dialogue, ce qui donne une vision très touffue de chaque page. Mais se plonger dans la lecture est un réel bonheur car il y a un vrai talent d'écrivain, qui déploie des phrases amples et profondes, au fort pouvoir d'évocation, arrivant en quelques mots à cerner un univers, un sentiment.
Ici, l'écriture est au service d'un projet ambitieux : raconter à travers la vie de ses quatre tantes Annabelle, Alice, Armelle et Angèle, l'histoire, l'opulence d'une ville prospère et de ses habitants, des années trente aux années soixante et son lent déclin à la fin du siècle dernier. Ou comment à partir d'un matériel très personnel, arriver à généraliser, ouvrir la boîte aux souvenirs de son lecteur tout en racontant une France aujourd'hui disparue.
Pour ma part, c'est pas mal réussi. On sent un reste de naphtaline sur les vêtements, les bois cirés, on voit les napperons en dentelle sur la table du salon, on se courbe à cause la vie codifiée et rigidifiée par les bonnes moeurs et le qu'en dira-t-on. Pourtant, le passé rejaillit sans aucune nostalgie. On sentirait même une légère ironie pour tous ces personnages qui ne semblent avoir trouver une vraie liberté d'esprit que dans la dernière partie de leur vie, une fois que les convenances n'eurent plus autant d'importance.
Cependant, la construction par période non chronologique m'a un peu gêné, je me suis un peu mélangé dans les personnages, comme l'invité d'un mariage à qui on présente tous les membres d'une famille d'un coup. Mais une fois plongé dans ces pages, on se laisse emporté par cette évocation brillante d'un monde désormais disparu. Il faut, je crois, pour apprécier ce livre, se réserver de longues plages de lecture pour mieux s'immerger dans cet univers provincial suranné.