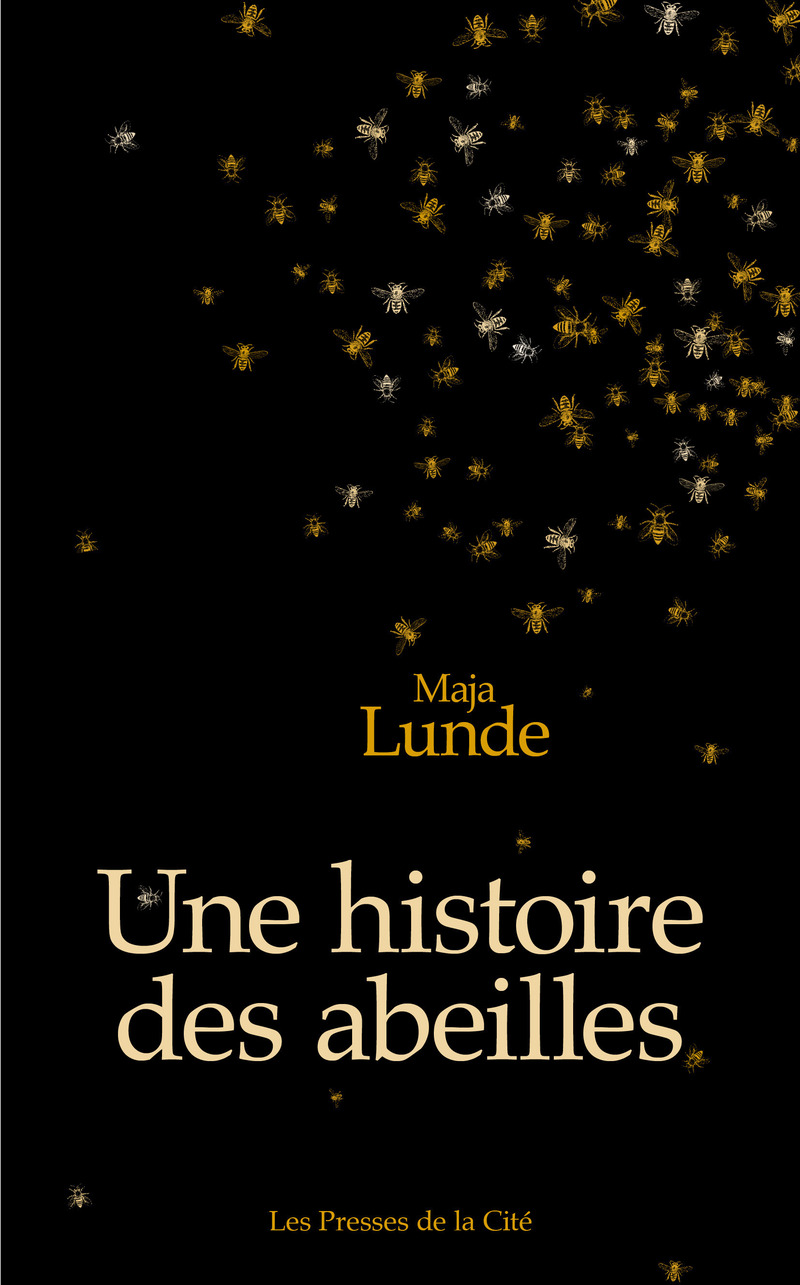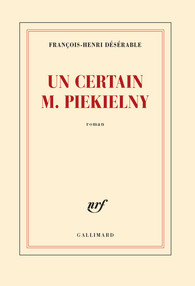N'ayez crainte, le monde paysan à l'écran ne se résume heureusement pas au monde exposé par Karine Lemarchand, maquignonne en chef pour agriculteurs esseulés. Le premier film d'Hubert Charuel, même s'il évoque un peu le problème du célibat ou la présence souvent pesante de parents retraités à proximité, ambitionne de se servir de ce cadre pour explorer les zones plus sombres du thriller épizootique dans lequel va se débattre un personnage principal ambiguë.
Globalement, le film réussit à nous emporter, nous faire frémir voire même nous émouvoir, signe que malgré quelques petites scories, l'objectif est atteint. Pierre, trentenaire sec et au regard inquiet, élève un troupeau de vaches laitières qui sont ses filles, ses femelles,sa seule raison de vivre. Il rêve des ses vaches, parfois sous forme de troublants cauchemars qui montrent l'envahissement des bovidés dans son cerveau ( scène d'introduction du film un peu fantastique mais qui n'ira guère plus loin dans ce genre). L'actualité agricole du moment, à savoir le virus FHB ( une fièvre hémorragique mortelle), lui fait redouter ce qui est arrivé à un collègue belge : l'abattage de son troupeau pour une seule bête atteinte. Chaque animal un peu fatigué ou souffreteux lui font monter la tension et lorsque la maladie atteindra effectivement l'une de ses vaches. un gouffre s'ouvrira devant Pierre. Les chemins qu'il empruntera face à cette situation ne seront pas ceux de la raison... et débute alors un genre de thriller psychologue assez intense...
L'amour est bien dans le pré, mais pas du tout celui que l'on croit. Ce même amour peut faire perdre son jugement et sa raison, même lorsqu'il s'agit de braves laitières baptisées Topaze ou Biniou. La force de ce film se situe bien là, dans ce portrait sans parti pris d'un agriculteur pris à son propre piège, engrenage fatal dont on se demandera constamment comment il va pouvoir s'en sortir. On le suivra jusqu'au bout de son raisonnement hasardeux, non pas par empathie mais par la force d'une réalisation rapide, nette, au cordeau. Certes le dernier tiers convainc un peu moins, l'émergence de quelques personnages ( les copains, l'éleveur belge) dilue le trouble précédemment mis en place, mais parvient tout de même à nous émouvoir. Qui aurait pu me dire que la dernière traite d'une vache puisse m'émouvoir ? ( Et je ne parle pas du sort réservé à Biniou !) Pour cela, le film possède un autre atout essentiel et de choix : Swann Arlaud, comédien déjà remarqué ailleurs, mais qui ici en impose carrément, portant le film de bout en bout, pour moi totalement crédible en agriculteur. Et j'ose espérer pour lui qu'il y aura un avant et un après "Petit paysan", tellement sa performance devrait lui ouvrir de beaux projets, tout comme on attend maintenant le prochain long-métrage de Hubert Charuel, qui signe un "Petit paysan" assez grand pour y déceler du talent.