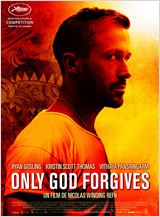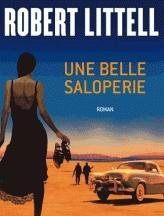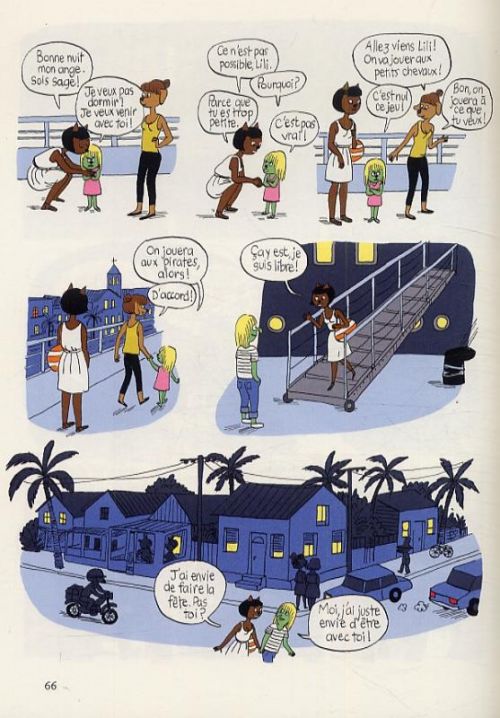S'il n'y avait pas eu
Entrée livre, le site communautaire de lecteurs, je n'aurai jamais posé un regard sur "
La preuve du paradis" du
Dr Eben Alexander, la littérature ésotérico-mystico-religieuse n'est absolument pas ma tasse de thé. C'est comme faire lire un roman érotique gay à monseigneur XXIII (et encore, peut être y prendrait-il du plaisir...). Donc, j'ai lu, en entier ce témoignage qui est censé nous prouver l'existence du paradis. pas moins !
Avant de vous donner mon humble avis, sachez que le doc
Eben Alexander, neurochirurgien émérite étatsunien, tombe dans le coma suite à une méningite bactérienne. Normalement, on ne ressort pas sans séquelles de ce genre de maladie...lui oui ! Et en plus, durant sa semaine comateuse, il a vu le paradis et donc rencontré une entité faite d'amour et de bonté : Dieu !
Les siècles passent, le charlatanisme lui ne change pas. Toujours prêt à exploiter la crédulité humaine, surtout par temps de crise, et désireux de se faire de l'argent sur le dos des indigents, les prédicateurs en tous genres font feu de tout bois. Hélas pour eux, ils usent, abusent toujours des mêmes procédés grossiers, le bon doc Alexander, malgré sa science, n'innove guère.
Tout d'abord, il met en avant deux mots souvent utilisés par tous les mouvements sectaires : famille et amour. Rien de plus beau, de plus simple que la famille et son amour qui est, c'est bien connu et prouvé, le remède à tout, le seul lieu protégé sur terre. Durant le coma de Mr Eben, la sienne priera beaucoup, ses amis allant même jusqu'à constituer partout aux Etats-Unis des groupes de prières qui lui permettront de quasi ressusciter. Je vous fais grâce du tableau ultra sympa de l'épouse et de ses deux fils aimants comme c'est pas possible, une version de la famille américaine comme il n'en existe même pas dans les séries les plus neuneux.
Autre moyen de faire gober l'impossible aux gogos, le crédit scientifique. Ici, le doc noie ses lecteurs dans des termes scientifiques, techniques et des démonstrations médicales trop complexes pour le commun des mortels, qui peuvent épater le sot, mais dont on devine que leur présence n'est là que pour asseoir une autorité qui n'admettra aucune remarque des personnes incultes à la prose médicale.
Autre technique pour emballer les futurs donateurs à une fondation à but soi-disant non lucratif créée pour l'occase : le repentir. Oui, moi, doc Alexander, j'étais incroyant avant mon coma ! (Entendons-nous bien, il ne pratiquait qu'à Noël et à Pâques mais cela suffit aux states pour faire de lui un incroyant!). Mais depuis que j'ai vu et ressenti la lumière divine, Dieu est partout en moi...
Dernier moyen pour emporter l'adhésion des imbéciles, fourguer dans son verbiage une dose de romanesque à deux balles pour faire larmoyer les foules. Le bon doc Alexander est un enfant adopté. Heureusement pour lui, sa famille adoptive a été aimante (Ah bon, elle pouvait ne pas l'être ? ). Comme elle ne lui avait rien caché de son adoption, il a cherché sa famille biologique. Et, ouf, en la retrouvant, il apprendra qu'avant d'être abandonné, il a été aimé très très fort et qu'il a eu par la suite une soeur, Betsy, hélas morte aujourd'hui....
Je range un instant mon mouchoir pour revenir à la question essentielle. Et le paradis dans tout ça ? Il l'a vu, il y est allé. C'est comment ?
Là, c'est un peu décevant. Sur plus de 200 pages, on tourne autour du pot, on touille les concepts fumeux. En cherchant bien, on en trouve tout de même une courte description à la page 62. Je ne résiste pas au plaisir de vous la livrer :
"....je n'étais pas seul là-haut.
Quelqu'un était à côté de moi: une belle jeune femme avec des pommettes hautes et les yeux d'un bleu profond. Elle portait le même type de vêtements de fermiers que les gens du village d'en dessous. Des tresses mordorées encadraient son joli visage. Nous volions tous deux, posés sur une surface aux motifs intriqués, vivante et pleine de couleurs indescriptibles et éclatantes -l'aile d'un papillon. En fait des millions de papillons étaient autour de nous - de grandes vagues ondulantes de papillons plongeant dans la verdure et revenant voleter auprès de nous. Ce n'était pas un seul papillon distinct qui était apparu, mais tous ensemble en même temps, comme s'ils formaient une rivière de vie et de couleur en se déplaçant dans l'air. Nous volions en formation libre au-dessus des fleurs et des bourgeons chatoyants sur les arbres, qui s'ouvraient alors que nous passions près d'eux."
Je ne rajouterai rien. Il a dû fumer des Polly-Pocket ou des My little poney... mais il n'est pas fort sur l'imagination le bon doc Eben. Rien de nouveau sous le soleil... Ah au fait, la fille qui vole avec lui, c'est sa soeur morte dont il a retrouvé une photo après son coma... C'est pas beau la vie ?
En conclusion, je ne nie pas le coma de ce brave (!???) doc
Eben Alexander. Je pense seulement que sa méningite bactérienne, contrairement à ce qu'il dit, lui a laissé des séquelles nombreuses et irrémédiables dont beaucoup à but lucratif. La médecine rapporterait-elle moins que le charlatanisme ?
Si, malgré tout, vous désirez jeter un oeil sur ce truc, vous pouvez l'acheter en ligne sur
www.decitre.fr