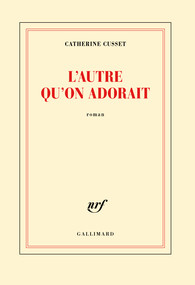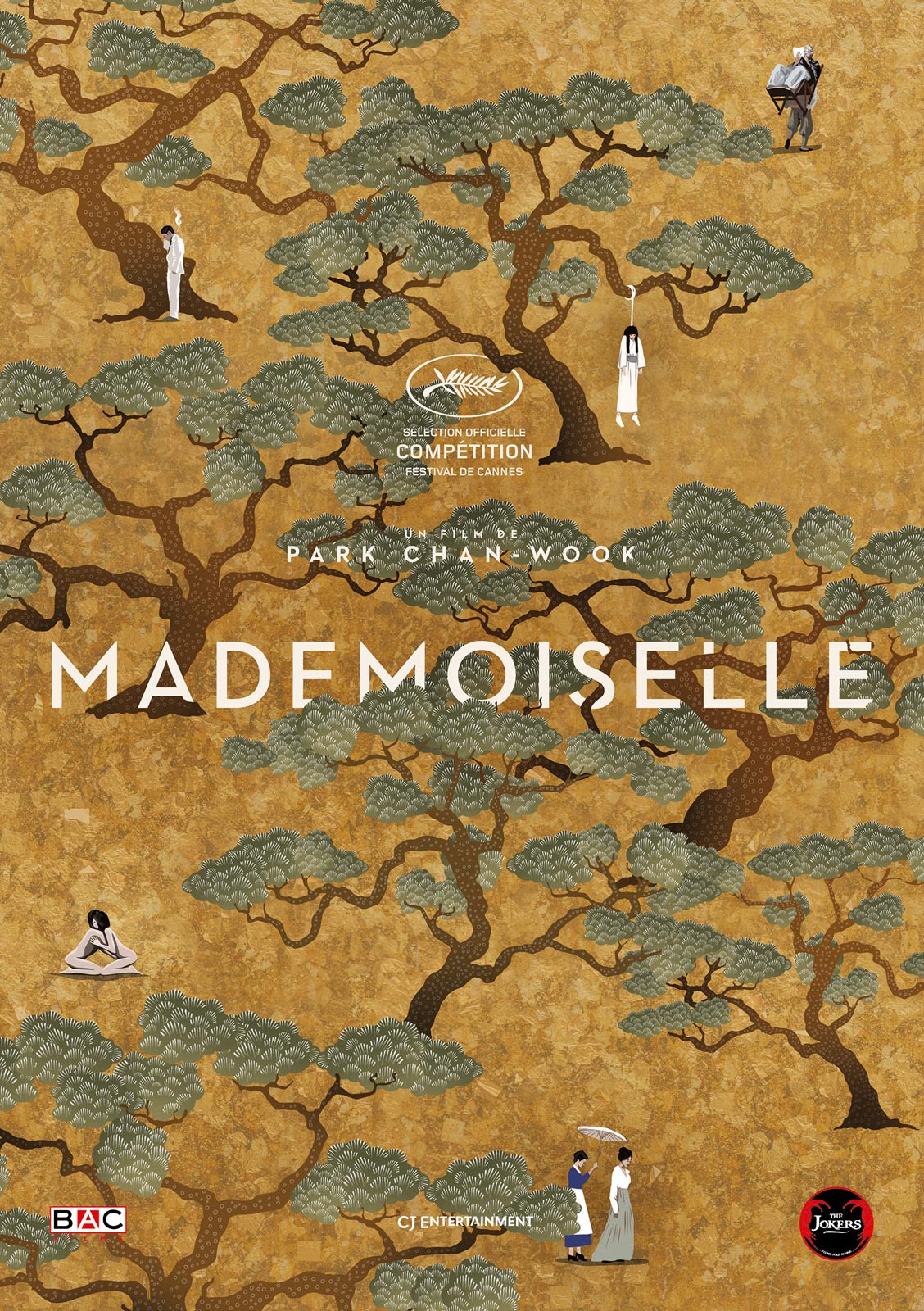AVERTISSEMENT : Certains passages de la chronique qui suit pourront choquer quelques âmes sensibles surtout si elles portent des sweat-shirts roses, prient quelques idoles variées, votent à droite (toutes tendances, et surtout les plus extrêmes), à gauche aussi, voire hélas trois options à la fois !
Dans son nouvel essai, Caroline Fourest, vigie sensible et indispensable, se penche avec ferveur sur un concept très français : la laïcité. Nous sommes l'un des rares pays au monde à avoir séparé l'église de l'état, avec la fameuse loi de 1905, renvoyant le religieux dans la sphère privée. C'est le socle sur lequel, depuis plus d'un siècle, repose notre République. Ce modèle original, source de bien d'incompréhensions de part des autres peuples qui nous observent comme des bêtes curieuses, n'arrivant pas à imaginer un état sans la participation de quelque dieu, continue de résister malgré les incessantes attaques venues de partout ( médias, politiques comme religieux) et les nombreuses interprétations que l'on nous sert insidieusement depuis la vague d'attentats ( creuset du racisme, de l'intolérance, de la haine, responsable de la radicalisation de quelques uns). L'essayiste va démonter tout cela point par point, clairement, sans haine, sans hargne, avec juste un esprit clairvoyant qui rassure.
Dès la première partie, on plonge tout de suite dans le vif du sujet : régler leur sort à tous les faux procès divers et variés, venus de toutes parts (et même de journaux du soir !), de propagandes hallucinantes, parfois expédiées par les pays spécialisés dans la fabrication de djihadistes mais aussi d'un peu partout dans le monde. En multipliant les exemples, en décryptant les discours biaisés ou simplistes, en prenant appui sur les systèmes alentours où le religieux passe avant l'état, avec pour résultat un racisme encore plus prégnant que chez nous ( cf les USA), elle démontre qu'en aucune façon la laïcité ne favorise le radicalisme pas plus qu'elle ne fait de la France un pays raciste. Elle règle son compte à tous ces "spécialistes divers" qui ont leur place attitrée dans nos médias et qui habillent le mot " laïcité" d'intentions fausses, avec un verbiage prompt à semer la confusion plutôt qu'à éclairer les esprits ( et avec une volonté prosélyte évidente).
Ensuite, Caroline Fourest se penche sur les différents modèles de société ou comment on mêle ou sépare (rarement) le religieux et du politique. Tableau édifiant pour moi si français et si bien pétri de laïcité, et même inquiétant quand on perçoit, comme en ce moment, la reconfessionnalisation des esprits, qui va étrangement de pair avec la montée des droites extrêmes et des régimes fascisants. Après une quantité d'exemples, il apparaît que le concept de notre République laïque ( l'état libre de toute emprise de la religion) souffre d'être trop abstrait et surtout plus exigeant en matière de culture générale que celui, plus lisible, des pays démocrates où les églises sont libres de toute emprise étatique. D'où pour Caroline Fourest une urgence d'expliquer cette spécificité française qui nous protège bien plus qu'on ne le pense.
L'effort pédagogique qui devra être lancé, ne peut faire l'impasse sur l'histoire de cette laïcité, terreau indispensable pour une bonne compréhension. Depuis Henri IV s'enchaîne la longue succession de guerres à la barbarie insoutenable que les religieux ont imposé à la France durant des centaines d'années. ( C'est fou ce qu'à cause des religieux on a ou a eu comme guerres ou conflits.). Le siècle des lumières et la révolution française ( avec Condorcet notamment) vont commencer à poser les premières pierres d'un édifice qui s'érigera finalement durant la IIIème République où des hommes politiques à fortes statures ont réussi, dans une adversité que l'on a un peu oubliée, à imposer leurs convictions fortes et modernes. ( Aujourd'hui, nos hommes politiques pourraient prendre modèle sur les fortes personnalités qu'étaient Jaurés, Ferry, Buisson ( Ferdinand, pas l'autre bien sûr !), Combes, Briand, qui n'ont pas eu peur de se battre pour des idées pas toujours populaires). Caroline Fourest rappelle la violence des débats, aussi bien à l'Assemblée Nationale que dans la presse, qui a précédé le vote de la loi de 1905. Depuis, en cent ans, la laïcité a subi quelques assauts ( Loi Debré, accords Lang-Cloupet, ...), quelques étrangetés ( le concordat Alsace-Lorraine) et un rajout, la loi égalitaire de 2004 concernant les signes religieux à l'Ecole Publique qui fut hélas le début d'un terrain de jeu polémique, révélant une fracture profonde de notre société et des débats sur lesquels la dernière partie de cet essai va se pencher. Fourmillant de détails, on voit apparaître le dangereux positionnement de certains journaux, des têtes pensantes universitaires bien moins ou franchement pas laïques malgré leur intitulé de chaire, qui fragilisent un peu plus chaque jour notre modèle. On essaie de nous promouvoir une laïcité plus ouverte, plus incluante. Derrière ces mots, se cachent au moins sept façons de l'appréhender dont une seule dans l'esprit de la loi de 1905, les autres faisant la part belle aux religieux.
Comme Caroline Fourest est une jusqu'au-boutiste, elle ne se prive pas, et c'est bien normal, de tracer quelques pistes pour une vraie politique laïque, donnant au passage son avis clair et net sur des questions qui agitent notre société ; le voile à l'école, les menus sans porc, le burkini, ... beaucoup de propositions qui montrent que la laïcité est vraiment un bouclier qui nous protège de dérives sectaires et religieuses, un rempart contre le racisme.
Je ne résiste pas au plaisir d'en citer une qui me plaît énormément, quitte à faire frémir beaucoup de bobos et tous les religieux. Petit rappel : "La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte." ( article 2 de la loi de 1905), beaucoup plus simple que de devoir être à l'écoute de toute une multitude... Or depuis une certaine loi Debré, l'état verse chaque année 11 milliards d'euros aux écoles privées, qui en plus d'exercer un indéniable prosélytisme, trustent les enfants issus de milieux favorisés, accentuant de fait la fracture sociale. Leur enlever leurs subsides et les réserver à l'Ecole Publique, laissant le privé se financer tout seul, résoudrait plusieurs problèmes. Avec un retour massif des enfants du pays dans l'école de la République, plus de problème de carte scolaire, retour d'une plus grande mixité sociale et surtout utilisation de cette somme astronomique pour instruire ceux qui en ont le plus besoin ( ZEP) dans une école où chaque enfant, quelque que soit son origine, pourra recevoir un enseignement aux buts identiques : une éducation sans préjugés. ( libre aux parents de leur donner une instruction religieuse en dehors). Je sais bien qu'une telle proposition ouvrirait une nouvelle "guerre" scolaire. Mais n'est-il pas temps de prendre le taureau par les cornes en commençant par la base et surtout en appliquant cette loi qui nous protège réellement de cette radicalisation des esprits ? Elle n'est, si on la regarde bien, ni raciste, ni excluante mais répond parfaitement à notre chère devise : liberté, égalité, fraternité.
Caroline Fourest le démontre brillamment dans son livre. Pourvu qu'elle soit lue et entendue !
Et pour tous ceux qui ne manqueront pas de la trouver trop raide face aux religieux, regardez l'actualité. Dans un pays démocratique, où l'on fait la part belle aux religions, soi disant moins raciste, regardez ce que cela vient de donner : l'élection de Donald Trump qui plonge le pays dans une fracture dont il aura du mal à cicatriser les plaies et qui laisse prévoir des jours bien sombres.
C'est quoi l'une des phrases de conclusion de "Génie de la laïcité "? " Au rythme où frappent les attentats, ce sera la laïcité ou le fascisme." N'aurait-elle pas tristement raison ? Alors protégeons-nous et surtout ne méprisons pas notre laïcité, bouclier culturel inégalable !