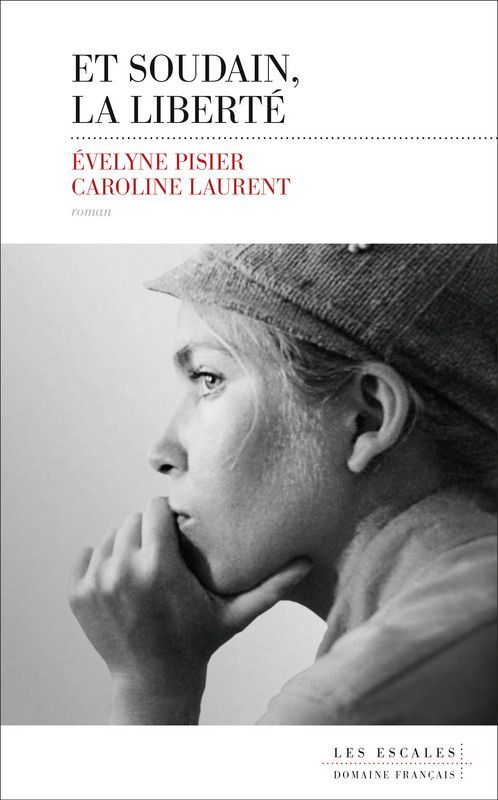Elle s'est posée dans un quartier de la banlieue de Londres, n'a pas défait ses cartons et ne pense qu'à une chose : se balader le long de la Léa. Non, Léa n'est pas une femme ( évacuez tout de suite la notion de roman érotique) mais un affluent de la Tamise. On nous parle donc beaucoup d'hydrographie ( ah déçu(e)s...parce que si on vous avez proposé de la pornographie vous auriez été intéressé(e)s ? ). Elle se promènera donc beaucoup, observera l'eau, les animaux qui vivent autour, les plantes qui y poussent. Armée d'un polaroïd, elle photographiera ces paysages ( le roman nous restitue ses clichés, assez banals et en noir et blanc). Quand elle reste dans son quartier, elle observe son voisinage, un commerçant croate, des enfants se rendant dans une école religieuse, l'épicier Katz... Mais ce qu'elle préfère ce sont ses promenades solitaires au bord de l'eau. Et dans sa solitude, elle repense à d'autres rivières qui ont composé le paysage intime de sa vie : Le Rhin de son enfance, Le Saint Laurent au moment où, jeune, elle a mis au monde un enfant, mais aussi le Gange, la Neretva, ...De temps en temps, elle croisera fugacement quelques humains, un acrobate notamment...
"La rivière" nous convie donc à une longue balade poétique ( 400 pages...quand même ) avec une héroïne jamais nommée dont on ne saisit pas vraiment le but ( à par aller au bord de l'eau... mais ça on le comprend vite qu'elle fait une fixette sur les réseaux fluviaux, des constructions qui la bordent jusqu'aux détritus qui la jonchent) et dont les souvenirs personnels qui affluent de temps en temps ne nous aident jamais à la définir vraiment. Le texte a beau être magnifiquement traduit ( de l'allemand), son caractère un peu obsessionnel ne m'a pas particulièrement passionné. Certes au bout de 150 pages, la mélancolie ambiante finit par donner à ce texte une vraie densité poétique, mais cette errance personnelle ( un peu trop sans doute) qui ne joue jamais le romanesque ou l'empathie tant avec les lecteurs qu'avec le peu de personnages rencontrés, a pris pour moi les allures d'une sortie hivernale sous la pluie et dans le froid avec seulement des baskets pour marcher dans la boue.
Pour conclure, je dirai que c'est sans doute très beau, très bien écrit mais très rasoir. Cette déambulation poétique volontairement lointaine conviendra aux lecteurs contemplatifs épris d'hydrographie ou d'expérience littérature. Personnellement, je suis resté à la porte ...heu...au bord, de cette rivière et du coup ne m'a pas emporté.