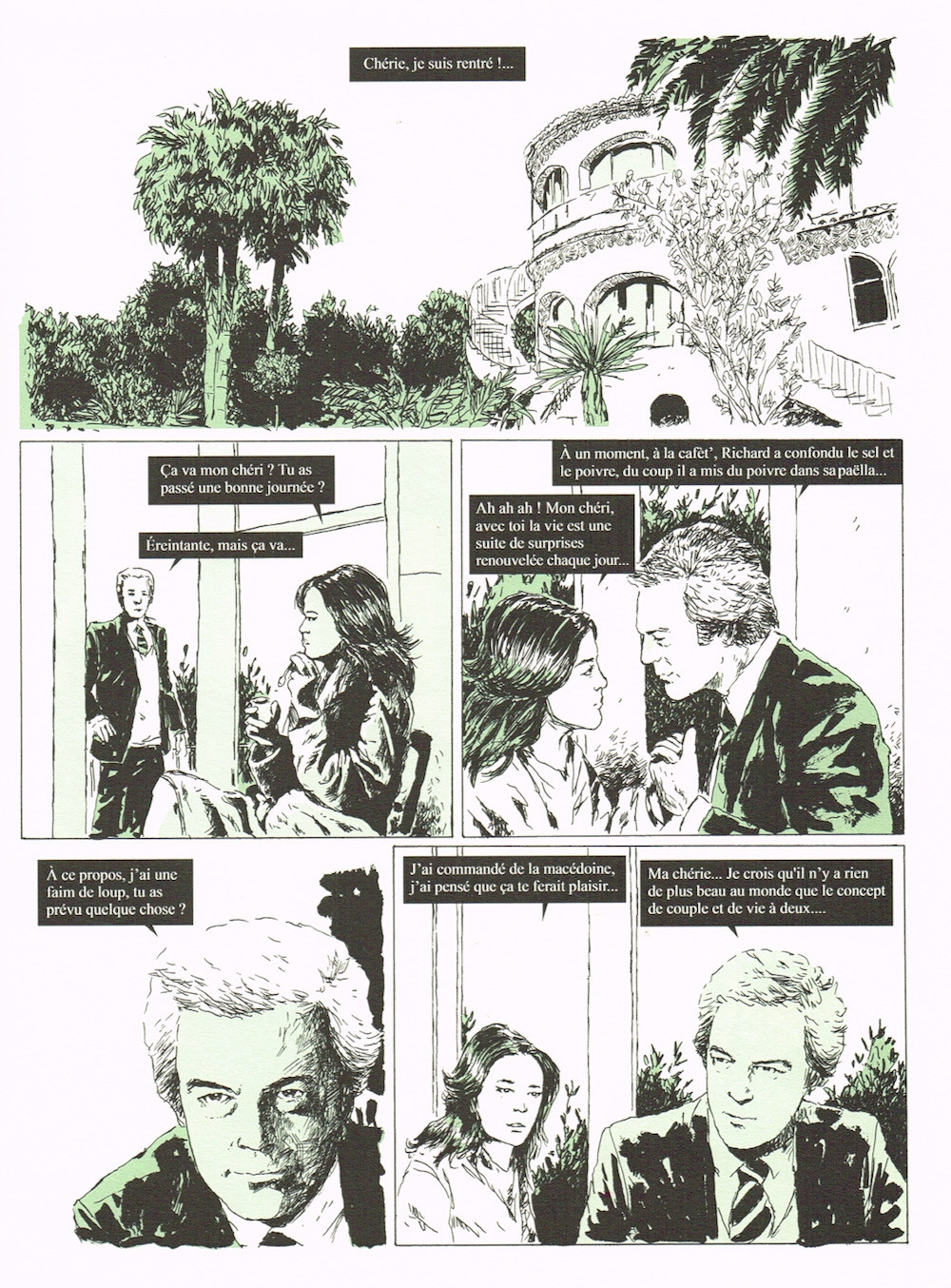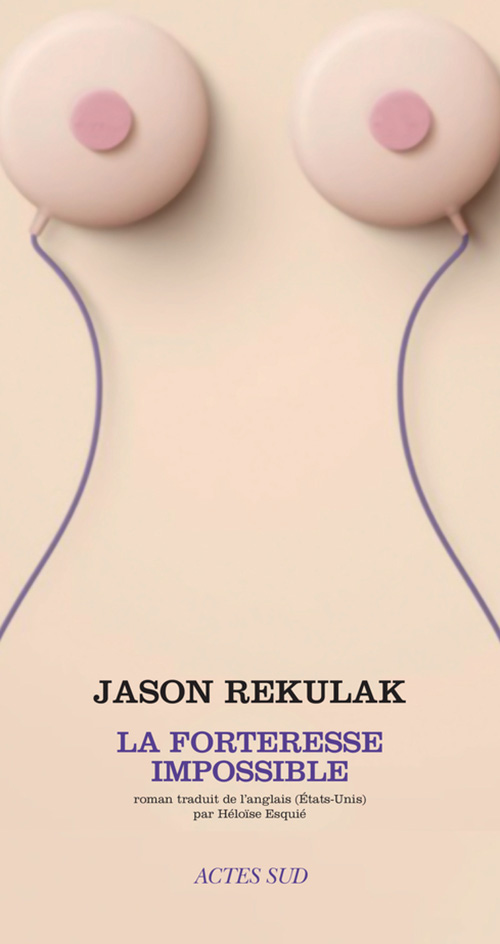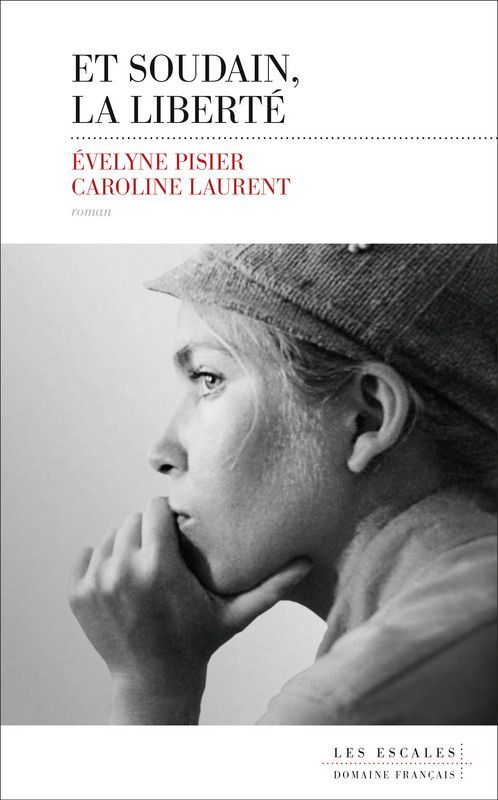" Le coeur à l'aiguille" ne permet aucun résumé
sinon, si par hasard vous venez à lire ce premier roman, son intérêt en serait
sans doute altéré du coup, évitez la quatrième de couverture trop explicite !). Donc, un numéro d'équilibriste m'attend, dire mes
impressions en divulguant le moins possible... marcher sur un fil donc...
Je ne divulguerai pas grand mystère en révélant que l'héroïne, chez elle, seule, coud une robe,.... le titre
l'évoque un peu. Cette activité, surtout dévolue en ce moment à d'infantiles mains asiatiques ou à quelques fashionistas
tendance bobo, dans les premières pages, donne à la couturière du roman un air de vieille fille délaissée qui continuait à faire revivre
un amour passé d'une façon un peu particulière. Peut être n'ai-je pas été très
attentif durant le premier chapitre mais c'est l'impression que j'ai retirée de
cette écriture à la fois précise, poétique et un peu précieuse. Et puis, petit
à petit, le tableau va se préciser, la femme vieillissante est bien plus jeune,
perchée sur des stilettos, de plus en plus éloignée de l'image que j'en ai eue au départ...
Durant la première partie, l'auteur
joue un peu avec nous. Elle dévoile petit à petit son intrigue à mesure que ce personnage principal se précise, s'ingéniant à déjouer des
images que l'on s'était fabriqué ( bêtement sans doute, perchée sur des talons
fins de 12cm, je l'avais imaginé un peu grande et mince.... alors qu'elle est
petite et grosse). Tout fonctionne un peu ainsi, même l'histoire d'amour
évoquée apparaît un peu idéalisée par l'héroïne, seuls quelques éléments glissaient ici ou là au milieu de cette dentelle romantique, nous amènent fortement à y penser. Mon intérêt fut maintenu par ce soupçon
de causticité planqué au milieu de toute cette description pleine de joliesses et de sensibilité.
Puis, le récit a pris pour moi une voie plus convenue ( mais mes impressions étaient peut être sur une fausse
piste). La dernière partie se laisse emporter par la pente sentimentale. Même si je persiste à croire que l'amour décrit se trouve enjolivé par les souvenirs, le roman emprunte bien le chemin du sentimentalisme, celui
dans lequel l'héroïne, à juste titre, s'est enfermée.
Sous des airs doux et poétique,
"le coeur à l'aiguille" laisse une belle impression d'ambiguïté et
montre qu'un couple, c'est une alchimie toujours particulière que
chacun vit selon ses désirs propres. Et quand le temps des
souvenirs s'en mêle.... où est la vérité ?
Le roman ne prend pas partie,
préférant taquiner la part sensible et poétique de ses lectrices/lecteurs tout
en se servant de l'aiguille pour piquer un peu, mais juste un peu, histoire de
ne pas faire de l'ombre à cette histoire qui est, au fond, émouvante.
Pas tout à fait la coupe qui me va,
mais il est indéniable que le tombé peut apparaître flatteur.